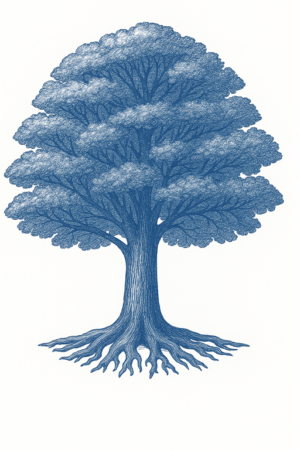En continuant de naviguer dans le texte de John Rawls, il m’est apparu que la fiction de la position originelle favorisée par le voile d’ignorance n’était peut-être pas si éloignée que ça de la réalité, mais sous un angle radicalement différent de celui de Rawls. Le travail de l’idéologie n’est-il pas à prendre comme une sorte de voile d’ignorance ? Comment expliquer autrement que tant de gens votent contre leurs propres intérêts ? Vous me direz que le voile d’ignorance de l’idéologie ne favorise pas l’émergence d’une rationalité neutre qui, en tant que neutre, serait la source originelle de décisions, de production de concepts allant dans le sens d’une justice équitable, c’est-à-dire bénéficiant à tous. Mais tout de même, celui qui est guidé par son idéologie ne véhicule-t-il pas l’idée de sa propre rationalité ? La conviction n’amène-t-elle pas avec elle le principe de certitude, une certitude qui se concrétise dans l’idée d’une rationalité, dans l’idée d’une raison. La certitude n’est-elle pas la source d’un voile d’ignorance derrière lequel le sujet se pense comme neutre, pratiquant une rationalité neutre suivant ses propres principes, ceux de son idéologie ? Et ce sujet, dans son intime conviction, ne prétend-il pas que sa rationalité est la meilleure pour tous ?
Quels que soient les arguments de Rawls, nous voyons que sa conviction, en ce sens, a la structure d’une idéologie, qu’il prétend architecturer à la perfection. Tous les développements de Rawls, non content de croire avoir écarté le pulsionnel et le social, nient purement et simplement la faillibilité de toute pensée humaine, sa fragilité face au réel. Comment penser une justice qui prenne en compte, non seulement le pulsionnel et le social, mais aussi la fragilité et la faillibilité de la pensée, du sujet ? Où est la garantie de possibilité d’une pensée purement rationnelle, autre qu’utopique, si l’on oublie volontairement que, bien souvent, c’est le langage qui nous parle plutôt que nous le parlons ? Nous avons vu à plusieurs reprises l’an passé, et quelques fois déjà cette année, que nous sommes des êtres de langage, des êtres traversés par de multiples discours, qui se rencontrent en nous, et qui nous parlent plus que nous ne les parlons, quand nous parlons. Les idées que nous exprimons nous sont d’autant plus étrangères, je veux dire par là qu’elles viennent des discours qui nous traversent plutôt que d’être originellement formulées par nous.
Ceci est encore plus vrai dans le cadre d’une idéologie, conçue comme un ensemble cohérent de discours qui va venir imprégner le sujet jusqu’à modeler le discours du sujet, sa propre pensée, tout en le convaincant que là est bien la seule véritable rationalité. La raison à laquelle fait appel Rawls n’est jamais définie par des critères, qui apparaitraient eux-mêmes comme rationnels, elle est une raison abstraite, allant-de-soi, qui se pose comme la source naturelle et nécessaire d’un fondement universel de la justice.
L’argument de la raison, qui est absolument central dans La justice comme équité, repose pourtant sur un certain nombre de principes. Nous retrouvons le premier d’entre eux chez Locke. C’est l’idée de la loi naturelle et de l’état de liberté, exprimée dans le Deuxième traité sur le gouvernement en 1690. Dans le même Traité, il y a aussi la première formulation du contrat social que reprendra plus tard Rawls. Pour Locke, les individus créent cette institution qu’est l’État, en consentant volontairement et mutuellement à lui déléguer la protection de la liberté et de la propriété. La sortie de l’état de nature établit la nécessité du contrat social, de la Loi et de la justice. Il peut ainsi exister différentes formes de gouvernement, comme l’oligarchie, la monarchie ou la démocratie, suivant différentes idées de défense du bien commun. C’est pourquoi Rawls voit, tout comme Locke, le pouvoir législatif comme étant le grand organisateur de toute société dotée d’une institution comme l’État. Un grand organisateur qui reste malgré tout soumis à la volonté du peuple. Ce qui écarte, par exemple, la légitimité d’un pouvoir issu d’une conquête, ou l’établissement d’une dictature. Si l’on se tourne ensuite vers Rousseau, et en particulier vers le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de 1754, nous retrouvons l’idée de loi naturelle, qui était déjà chez Locke, dans laquelle les hommes seraient mûs par leurs besoins et leurs instincts, et ne connaîtraient pas l’inégalité. Le premier homme qui dit « Ceci est à moi » après avoir « enclos un terrain » est l’inventeur de la propriété privée, rompant la loi naturelle. C’est le début de la richesse et de la pauvreté, et des inégalités qui en découlent. Quelques années plus tard, dans Du contrat social, en 1762, Rousseau prolongera cette idée d’état de nature par sa théorie du contrat social. Il nous dit que l’autorité familiale, la soumission au plus fort ou l’esclavage ne procèdent pas d’accords mutuels volontaires. Le fondement légitime d’une société réside en un pacte social qui forme l’unité politique du peuple. Là aussi c’est la volonté populaire qui règne sur l’État et sur l’ensemble du peuple, confiant à l’État le soin de préserver la liberté et la propriété privée, et se substituant à la loi naturelle.
Travaillant, comme précédemment dans la Critique de la raison pure et dans la Critique de la raison pratique, à la construction d’une métaphysique universelle, Kant, en 1796-1797 dans sa Métaphysique des mœurs, formule le concept d’impératif catégorique. L’impératif catégorique ne dépend de nulle situation et est universel. Il est au fondement de l’action. Contrairement à la téléologie de l’impératif hypothétique. Une des formulations de cet impératif évoque une volonté législatrice universelle autonome, dont n’est pas très éloignée la position originelle chez Rawls. Cette volonté autonome, chez Kant, se donne à elle-même sa loi morale, dans l’exercice de la liberté. Nous retrouvons là la confusion entre le concept et la réalité effective que nous avions déjà pointée chez Rawls. C’est par ce forçage que Kant peut affirmer la suprématie de la liberté, puisque sans elle il n’y aurait pas de volonté autonome. Ce n’est pas le concept qui produit la réalité, pas plus que le politique ne produit l’organisation d’une société.
Ces quatre penseurs, Locke, Rousseau, Kant et Rawls, partagent tous la même idée du politique, de la liberté et de l’égalité, du contrat social, en écartant ce qui résiste. Car il ne relève pas de la volonté générale que dans un monde régi par la marchandise le capital et le travail soient séparés. C’est le résultat d’un processus historique, indépendant de toute volonté individuelle ou collective, de tout contrat social, qui fait émerger l’État pour lui déléguer le maintien de la division entre capital et travail et lui faire assurer le bon déroulement de la production des marchandises. C’est aussi le point d’achoppement majeur de ces théories. Comment penser l’apparition de la société civile et de l’État si ce n’est par des processus qui leurs sont extérieurs ? Comment penser la justice sans l’histoire ?