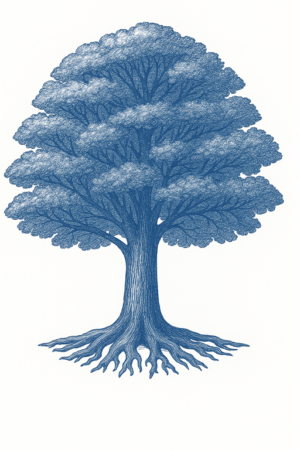Il nous a été demandé par une amie, lors de notre dernière séance, ce que proposait Rawls, et ce que nous pouvions en dire au-delà de la critique, déjà abondante, que nous avons fait des fondements de son texte, en particulier par son ignorance du pulsionnel et de l’idéologique, du désir et du langage, mais aussi dans son utopisme rationaliste.
Disons donc quelques mots sur ce qu’il propose.
Après avoir développé les fondements théoriques de son système, justice comme équité, principes de la justice (principe de liberté et principe de différence), et position originelle (le voile d’ignorance), Rawls en vient à définir l’application de ces principes aux institutions, en faisant toujours primer la liberté sur toute autre considération, y compris les considérations d’ordre économique.
Le premier principe de la justice comme équité : chaque personne doit avoir un ensemble égal de libertés fondamentales compatibles avec celles des autres. Rawls élabore une méthode en quatre étapes, pour pouvoir les appliquer à une institution : constitution, législation, interprétation judiciaire et jurisprudence, et décisions individuelles. Ce qui doit permettre une cohérence dans l’application de la justice à tous les niveaux.
La liberté est pensée comme un système de droits et de devoirs, définis par des institutions publiques équitables, et non comme absence de contraintes. Les libertés fondamentales sont la liberté de conscience, de pensée, d’expression, d’association, les droits politiques et la protection juridique. Ces droits doivent former un ensemble cohérent.
La liberté de conscience est particulièrement importante. Elle est choisie dans la « position originelle », dans laquelle les individus sont censés ignorer leur position sociale, en faire volontairement abstraction, ce qui doit garantir une protection impartiale des croyances et des opinions de chacun. L’égalité des droits politiques assure quant à elle une participation équitable à la vie démocratique.
Dans ce système, la liberté ne peut être restreinte que pour la préservation de la liberté d’autrui. C’est le fameux « La liberté de l’individu doit être ainsi bornée : il ne doit pas se rendre nuisible aux autres » de John Stuart Mill (De la liberté, 1859). Aucune justification économique, par exemple, ne peut primer sur les libertés fondamentales. Ce principe protège les droits individuels contre les décisions utilitaristes ou majoritaires,
La liberté occupe ainsi la place centrale dans la justice comme équité. Elle structure la coopération entre des citoyens libres et égaux.
Suivant le deuxième principe de la justice comme équité, les inégalités, bien que reconnues et maintenues, ne sont estimées justes que si elles bénéficient aux plus défavorisés et qu’elles sont contrebalancées par l’égalité des chances. Suivant cette logique, la justice procédurale fournit le cadre institutionnel qui rend possible une distribution équitable, la justice dépendant de la justesse des procédures et des institutions plutôt que de critères moraux qui seraient extérieurs aux procédures elles-mêmes. Ce ne sont pas les finalités ou les résultats qui priment, mais les principes de la justice et leur juste mise en œuvre.
Suivant ce souci d’équité, de liberté et d’égalité juridiques, les droits des individus se fondent sur leurs attentes légitimes, établies par des règles publiques justes, et non pas sur le mérite moral, ce qui évite de légitimer l’établissement de privilèges sociaux injustifiés.
Différents systèmes économiques peuvent convenir ici (capitalisme, socialisme, économie mixte), tant que ces systèmes respectent les deux principes de la justice comme équité, l’essentiel étant que les institutions garantissent les libertés fondamentales et que les inégalités bénéficient aux plus désavantagés.
Par ailleurs, rapide précision, pour que ce système puisse s’inscrire dans une perspective historique et de transmission, il doit être préservé dans le temps. C’est ce que Rawls appelle le principe d’épargne juste, qui vient garantir la justice entre les générations. Chaque génération se doit de transmettre un cadre de justice équitable aux générations suivantes.
Dans ce cadre, il y a deux types d’exigences morales :
- Les devoirs naturels, qui s’appliquent à tous sans engagement volontaire, et qui incluent l’aide mutuelle et le respect d’autrui. Ils assurent la stabilité morale d’une société.
- Les obligations, fondées sur le principe d’équité et relevant d’une adhésion aux institutions, engagent ceux qui tirent volontairement avantage d’un cadre institutionnel juste et équitable.
Il n’y a pas d’adhésion explicite aux devoirs naturels, mais il y en a bien une en ce qui concerne les obligations. C’est elles qui relèvent du contrat social. Les droits et devoirs naturels sont antérieurs et extérieurs au contrat social et reposent sur la personne morale raisonnable, que nous sommes tous censés être : devoir de justice (soutenir des institutions justes), devoir de ne pas nuire, devoir d’assistance mutuelle, respect de la dignité des autres.
Le devoir, naturel, de justice est ici central : il impose à chacun de soutenir ou d’établir des institutions justes et équitables. Et même si des lois injustes peuvent exister dans une société globalement juste, il faut leur obéir, sauf si celles-ci violent gravement les principes fondamentaux. Dans ce dernier cas, la désobéissance civile peut se manifester à travers des actes publics, politiques et non-violents, ou l’objection de conscience. Ces formes d’opposition morale montrent que la justice comme équité implique une responsabilité civique active, qui ne se borne pas au simple respect des règles.
Les obligations, de leur côté, relèvent d’un engagement actif : promettre quelque chose, accepter les bénéfices d’une institution, participer à une entreprise collective régie par des règles.
Les devoirs naturels rendent possible la coopération morale minimale entre égaux. Le contrat social formalise les engagements des citoyens au sein d’institutions justes.
L’articulation entre ces deux dimensions permet à Rawls de faire la jonction entre une dimension universaliste, les droits naturels, et une dimension contractuelle, les obligations.
Nous pourrons nous demander aujourd’hui, comme cela avait été évoqué la semaine dernière, s’il est concevable d’organiser le lien social sur cette base de justice rationnelle, universaliste et contractuelle, ou si elle ne représente pas qu’une partie seulement des nombreuses dimensions constitutives du social (comme l’économie de la production et des échanges, les structures de parenté, l’économie domestique, le politique en tant que distinct du juridique, le religieux, et ainsi de suite), et en rien la partie directrice de l’ensemble.